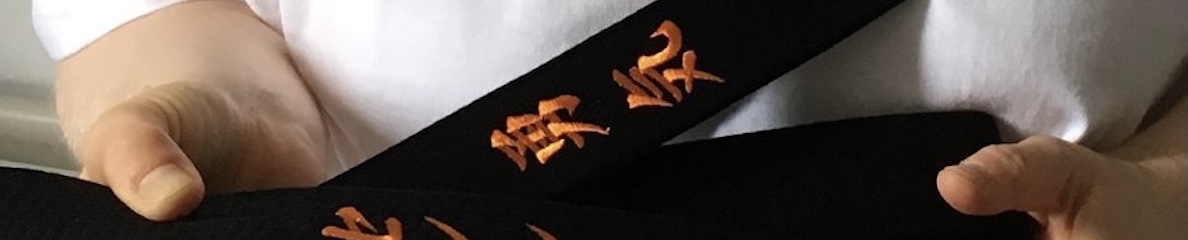[Archive]
Je publie ce texte en écho à un billet en ligne le 2 décembre 2023 où le temps se distord. J’aime beaucoup cette nouvelle publiée en 2005. Je me réjouis de la partager avec vous.
-:-
Le rêve d’Isabella
in : coll. Transports amoureux, Éditions La Cerisaie, mai 2005 160 pp.
Ablation intracardiaque par radiofréquence.
Cette intervention consiste à introduire des sondes à l’intérieur du cœur via la veine ou l’artère fémorale. Ces sondes permettent l’ablation (cautérisation) de faisceaux responsables de troubles du rythme cardiaque.
Elle me regardait, paupières closes. Il est impossible de regarder quelqu’un les yeux fermés. Et pourtant, je peux le jurer, elle me regarde. Elle me regarde ou elle me regardait ? Le temps n’existe pas dans cette histoire ou plus exactement, il se dilue à une vitesse distordue. La vitesse du temps ne se distord pas, si l’on reste immobile, bien sûr. Le verbe distordre est-il le bon ? C’est celui que je choisis. Il va falloir l’accepter : dans cette histoire, les dimensions habituelles du temps et de l’espace nous sont inconnues ; seul le corps pèse son poids, ou à peu près, et l’esprit est si proche de faire émerger l’inconscient qu’il en devient presque encombrant. Je balance ma tête de droite et de gauche. Je veux tout voir. Peu de choses m’apparaissent. Je dois rester calme. J’entonne en sourdine la chanson de cette pièce de Jan Lauwers vue cet été au cloître des Carmes. Pourquoi cette musique ? Il manque un chœur pour donner matière au canon ; Isabella m’indique d’un sourire qu’elle m’offre volontiers le sien.
Elle a dit « Ne vous inquiétez pas, je pose la perfusion ; là ; c’est fait. » Elle piquait bien ; je n’ai rien senti ou alors je ne m’en souviens pas, ce qui revient au même. Que fait-elle à présent ? Je tourne la tête de son côté. Ses paupières sont toujours closes à moins que ce ne soit les miennes. Je la vois pourtant, avec sa charlotte sur la tête. Il est impossible de voir avec… Oui, on sait, cette histoire a le temps de la vitesse distordue ou quelque chose d’approchant. Ensuite Isabella m’a expliqué que j’allais sentir une douleur dans le bras. Je n’ai rien senti non plus. Je le lui ai dit. Elle a eu l’air étonnée mais n’en a pas pris ombrage sous sa charlotte qui est identique à la mienne, le même bleu pâle, le pareil ridicule. A-t-elle aussi les fesses à l’air ? Je n’ai pas eu le temps de voir sous sa blouse. Le temps ? Où en est-il ? J’écoute. Il ne dit rien, ou alors je ne l’entends pas, ou alors je l’entends mais je ne le sais pas ou plus. C’est très compliqué, ces hypothèses. Je pourrais me concentrer un peu. Il paraît que je ne dors pas.
Il faisait un peu frais. J’ai réclamé une couverture. Il a demandé à l’infirmière de ne pas installer celle en papier dans laquelle un moteur externe pulse de l’air chaud : le moteur crée des interférences avec les appareils de mesure. On m’en couvrira plus tard, en salle de réveil. Je ne le sais donc pas encore mais cela est dans l’histoire, car le temps se distord. Oui, etc. La mélodie doit tourner en boucle. Je n’arrive pas à faire fonctionner la touche « Repeat ». Je dois me lever à chaque fois. Isabella chante. Elle n’est pas sur le CD, sa voix ; elle est dans mon souvenir. Elle est grosse, Isabella, énorme ! Elle est belle, même avec sa charlotte sur la tête. Elle sourit. Je l’entends. Il y a aussi son père qui chante, Arthur, bien qu’il soit mort. Il doit toujours y avoir une place pour les morts, dans l’histoire. Et Dieu ? Faut-il laisser une place à Dieu ? Pourquoi la mort, sa crainte surtout, me fait faire cette association d’idées ? Je suis allée à la messe, avant, au cas où. Où quoi ? Chacun devinera. Dieu, c’est donc réglé. Reste le père, Arthur, celui d’Isabella.
À l’autre bout de moi, en dessous de la ceinture, il est là ; je le sens qui débobine son fil ; il tapote sur ma cuisse ; je crois ; je sais ; j’imagine. Qui il ? Arthur ? Mais non ! il faut suivre, un peu, sinon, vous ne comprendrez rien à l’histoire. C’est le docteur C. K., celui qui m’opère le cœur. En fait, ils sont deux. J’ai pu les compter, un moment. Ils étaient deux mais ils ne font qu’un, un pour le fil, l’autre pour la bobine, ou le tir, et tous les écrans. Deux, pour tout ça, ce n’est pas plus mal. Cela rassure. Il va tirer. Il le dit. Lequel ? C’est K., j’en suis certaine. Je voudrais serrer le poing. Je m’accroche au manche à balai. Mon Corsair amorce un beau virage sur l’aile. Papy me fait un signe. On est des bons ; on va les avoir. Un instant, je remets la musique ; j’ai trouvé la touche « Repeat » au compte-fils ; j’appuie ; rien ne se passe. Je devrais prendre le temps de lire la documentation. Isabella me sourit encore. Elle a le visage très rond. Je tends la main vers ses cheveux. Ils sont cachés. Je ne les atteins pas. Mon poignet est lié à la table par une sangle de cuir.
— J’ai mal.
J’ai parlé. Je suis restée calme. Ma poitrine a tenté une sortie. Mon cœur bat très vite. C’est lui qui l’a décidé, lui C. K., car mon cœur, lui, n’aime pas tant que cela sortir de sa mesure. Il le fallait, distordre le temps de battement du cœur pour trouver le court-circuit. On ne distord pas le… Mais si ! allons, faites un effort. Isabella effleure mes doigts. Elle dit rajouter du… ? Je ne retiens pas le nom. Je lui demanderai plus tard de me le noter, pour pouvoir raconter l’histoire. Elle le fera. Elle est bien, c’est une grande dame, Isabella. Je l’aime. Déjà ? On n’en est pourtant qu’à 4.121 signes, 4.135, 4.142… à moins que je ne corrige des choses dans ce qui précède du récit. 4.216, voilà. Je ne recompterai pas, quoi que je modifie. On se moque du compte. L’histoire en est presque à sa moitié. C. K. me tripote toujours la cuisse. Je suis descendue en retard. Je trouverai des marrons glacés sur mon bureau à mon retour à la maison. J’adore les marrons glacés. Je les mangerai dans un temps distordu, deux par deux, l’histoire à toujours besoin de marrons glacés, toutes les histoires, c’est comme les morts, et Dieu. Les doigts de C. K. dansent sur ma cuisse. C’est l’heure d’aller en boîte. Mais où est la musique ?
— J’ai mal.
Mon cœur a encore voulu sortir. Je ne sais pas à quelle vitesse il bat. Isabella dit qu’elle met la dose. Je tourne de nouveau la tête vers elle. Je la distingue mal dans la pénombre. Je me souviens alors que j’ai gardé mes lunettes de soleil. Ce doit être pour cela que je ne vois pas tout d’elle. J’ouvre les yeux. Elle me parle de mon métabolisme. Sa voix est meilleure que la morphine. Je me souviens aussi que j’ai dû enlever ma culotte. Je n’ai pas de désir. Il annonce un troisième tir. Je remets la musique. Je ne veux pas sentir. Isabella me caresse la joue. Ses paupières sont closes. Elle dort à côté de moi, qui ne dors pas. Je n’ai pas la force de leur dire que j’ai à peine eu mal. La douleur est oubliée. Que fait la sonde ? Je mets de l’eau à chauffer, ma gorge est sèche. Le sang coule entre mes cuisses. Non, ce n’est pas du sang, c’est de la Bétadine. Il en a mis un paquet, C. K. J’en ai un collier autour du cou. L’eau bout. Je la verse sur la chicorée. Je bois. C’est trop chaud. Il tire. Touché, en plein cœur ! Je l’ignore. Comment puis-je alors le dire ? J’ai lu le compte rendu d’exploration. Déjà ? le temps est distordu et… Oui, c’est o. k. J’ai envie qu’Isabella me prenne dans ses bras.
J’ai envie. Quelle drôle d’idée d’avoir « envie » ? Être « envie », je ne dis pas ; mais avoir, même pas d’Isabella. Elle est moins ronde qu’elle ne l’était sur scène. J’aime ses formes. Elle n’est plus là. Elle revient. Elle s’en va. Elle est au milieu du décor, son père, Arthur, à sa droite, un peu en avant, sa mère, Anna, à ses côtés, et puis son cerveau droit, là, juste en face de moi. Il y avait en effet un danseur qui jouait le rôle du cerveau droit d’Isabella, et une danseuse pour le gauche, à moins que ce ne soit l’inverse, l’homme à gauche et la femme à droite. C’est un peu fou, non ? Qu’est-ce que la folie à part ne pas boire sa chicorée tant qu’elle est chaude ? Je vais la chercher car en vérité, je ne l’ai pas encore servie. Peut-on boire une boisson que l’on n’aurait pas servie, aimer quelqu’un que l’on n’aurait pas rencontré ? Ne dites pas non, vous vous priveriez d’une partie de l’histoire. C. K. pianote toujours sur ma cuisse. Rembobine-t-il le fil, les fils ? Il doit y avoir plusieurs fils puisqu’il y a plusieurs sondes. Isabella est revenue. J’aimerais qu’elle ouvre les yeux. Alors elle me verrait. Elle me voit déjà. Qui, de moi ? J’arracherais volontiers ma charlotte. Elle saurait que je suis blonde. Elle ne l’ignore pas. Je danse. Je fais des pas chassés. Isabella me rejoint. Nous dansons. Nous faisons ensemble des pas chassés. Et je fredonne.
On m’emporte. Le brancard arpente les couloirs souterrains. Je suis des yeux le chemin que tracent les tuyaux et les fils électriques. Cela part dans tous les sens. Je m’accroche à la mélodie. Isabella me manque. Elle nous suit. Elle le dit au brancardier. Ce mot m’évoque la guerre, celle des tranchées. C’est de circonstance, on m’a tiré dans la poitrine, quatre fois, l’écrira C. K. sur le compte rendu d’exploration. Je bois une gorgée de liquide. A-t-il bien enlevé la sonde ? Je n’ai pas moyen de vérifier. Isabella me parle. Elle a mis la dose ; elle le redit. Veut-elle chanter encore avec moi ? Je suis un personnage de trop. Je suis dans le public. Elle est sur scène. Elle rayonne au centre du cloître des Carmes. Elle est énorme, monstrueuse. Je l’aime. Encore ? C’est un peu tôt pour s’engager. L’amour n’engage pas comme on le pense. Il libère. Je suis en salle de réveil. Je m’ennuie. Deux infirmières papotent au loin. Un homme râle à mes côtés, et hoquette, et souffle comme un bœuf. Une femme avec une charlotte bleu pâle sur la tête vient le voir. Ce n’est pas Isabella. Elle ne m’intéresse pas. Elle demande à l’homme-bœuf s’il a mal. Elle lui dit de laisser sortir les gaz. Il se dégonfle. Cela me fait peur. Je cherche Isabella. Elle est dans la musique me dit le néon. Je respire fort dans le masque à oxygène. J’amorce un sourire chassé, puis un second. La platine repart. Le danseur au clavier donne le tempo. Il ne se distord pas. Le temps reprend son rythme habituel. Mon cœur bat. L’espace se rétrécit. Le corps a envie de dormir. L’esprit donne le la.
Isabella m’a dit avoir glissé sous ma tête un papier où elle a inscrit le nom des drogues qu’elle a utilisées. Elle a dit devoir partir. Elle est partie. J’ouvre les paupières. Elle est là, dans le reflet de mes lunettes, celles que j’ai achetées cet été. Cela me ramène à tout à l’heure, avant, pendant. C. K. a cautérisé le mauvais faisceau, le bon en fait, mais qui était mauvais. On me suggérera plus tard que c’était par là que transitaient les chagrins d’amour. J’aime l’idée. Le brancardier me ramène enfin dans ma chambre. Mon frère y est. Il m’attendait. Il réclame de pouvoir m’embrasser avant que l’on ne me porte dans mon lit. Il m’embrasse. C’est bon. On a eu peur. On est heureux. Il me dit que je suis très belle avec ma charlotte et mes lunettes. J’ai envie de la musique. Isabella trône dans sa chambre, à moins que ce ne soit dans la mienne. Ils m’ont mise au lit. Ils étaient quatre, cette fois. Ils ont trouvé sur le brancard ma culotte et le mot d’Isabella. Ils posent le tout sur la table à roulettes. Je remets la musique. J’ouvre les bras. Je fais l’avion. Je tire. Le Zéro est mort. Isabella vole avec moi. Ses paupières sont closes. Elle me regarde. Mon cœur saigne un peu. Ma jambe est immobilisée. Cela ne m’empêche pas de rire ni de danser.
Une dame a apporté un plateau-repas. Mon frère me coupe ma viande, du veau, peut-être. Il range mes lunettes de soleil. Le reflet disparaît. Il part. Je suis seule pour la première fois depuis des heures. J’ai envie de pleurer. Je ne peux pas. J’ai envie de sucer mon pouce. Je ne peux pas plus. Je tends la main vers la tablette, là où le papier plié en quatre est posé sous ma culotte, à côté de mon assiette. J’attrape le papier. Je l’ouvre. Je cherche mes lunettes, de vue cette fois, sur la table de nuit. Je les trouve. Je les chausse. Je lis.
« Drogues anesthésiques :
« Sufentanil = Sufenta
« Popofol = Diprivan »
Et je ferme les yeux. J’ouvre les bras, doigts écartés. J’avance comme un danseur de Pina Bausch, les bras tendus devant moi. Je roule du bassin. Je roule des épaules. Je passe par-dessus les genoux de ma voisine. Je descends les marches. Isabella écarte les danseurs. Elle vient à moi, me tend la main. Je monte la rejoindre sur scène. Nous dansons en apesanteur. Quelqu’un pourrait-il faire tomber le rideau ? Il n’y en a pas au cloître des Carmes. La lumière s’éteint. C’est tout ce qu’ils peuvent faire. Je me rapproche. Isabella m’étreint. Je me coule dans sa chair. Quelqu’un remet le courant. La scène est baignée de lumière. Les gradins sont pleins. Le public se lève, pour applaudir, sans doute. Isabella le fait disparaître. Feu le public. Le reste de la troupe nous observe. Isabella les désagrège. Feu les danseurs. Jan Lauwers est assis à son pupitre. Isabella le téléporte autre part. Feu Jan Lauwers. Et nous ? On se regarde, les paupières closes. Je n’ai toujours pas bu ma chicorée. Je remets la musique. N’est-il pas temps que le désir m’emballe ?
Cy Jung, décembre 2004