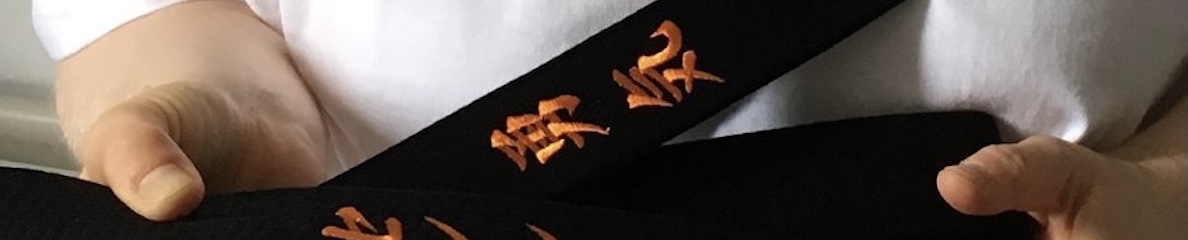J’ai publié le 26 septembre dernier les deux premières pages d’un texte érotique en écho à Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train. Les commentaires de Vincent me donnent envie de publier deux pages de plus qui donneront l’idée du patchwork annoncé. C’est si agréable d’avoir un lecteur qui ose parler du texte !
Cadeau.
-:-
Je ne veux pas bouger du baiser de ces trois matins. Sa peau est si fine. Je pourrais passer des heures à la lisser de ma paume. Elle est très blanche, légèrement rosée. Ce n’est pas une peau d’albinos. C’est plus une peau de visage pâle, une qui rougit au moindre rayon de soleil, laiteuse, goûteuse. Ses cheveux sont châtain clair, tirant parfois sur le roux. Ses yeux ? Je peine à ouvrir les miens. Elle est aussi nue que moi. Je n’ose la regarder. C’est étrange de penser que la toucher est plus facile. Je caresse ses cheveux. Les boucles courtes glissent entre mes doigts. C’est frais. Je ne sais pas pourquoi les cheveux donnent cette sensation de fraîcheur. Leur légèreté, peut-être ? Mes deux mains enrobent sa tête, pulpes contre son cuir chevelu. Elle roule sous la pression. Elle grimace quand mes doigts touchent un point douloureux. Je m’écarte et m’excuse. Elle prend ma main, la replace, se pâme presque sous les assauts de mes phalangettes. Elle grogne. J’en rougis. Mes bras donnent du muscle. Elle s’agrippe à mes hanches. Mon désir meurtrit mon ventre.
Je soupire.
Je voudrais que tout aille très vite. Je voudrais que cela dure. Ses doigts crochètent ma chair. Une main vient plus bas. Je gaine. Mes fessiers s’amusent à contrer leur attache. Ses doigts insistent. Elle rit.
— On ne peut donc pas te pincer les fesses !
— Disons que… cela se mérite.
Elle rit encore. Je me joins à son éclat. J’ai dû longtemps rêver d’elle, sans le savoir, pour sentir encore ce baiser dans lequel je me suis réveillée. Trois jours. Ou quatre ? Je ne compte plus. Ils sont comme des années, celles où je me suis dérobée à ses étreintes. Ma vulve bâille, elle qui pourtant s’étrécit. Elle ignore le point de vue médical. C’est heureux. Je suis là, découverte, ses mains sur mes hanches, mes doigts dans ses cheveux et je n’ai envie que d’une chose, jouir. Fondre ? Oui, une jouissance en forme de douceur. Un bonbon.
À la place, j’attrape un cure-dents et le colle entre mes lèvres. Je fumerais bien une cigarette. Le bruit, déjà, quand le tabac pétille sous la flamme du briquet, et la première goulée de fumée qui pique un peu les amygdales. Alors vient le fumet. Il chauffe les voies nasales. Le monde prend une touche bleutée. J’aime l’idée d’un orgasme à la saveur d’une anglaise à bout filtre. Mes incisives en cassent le cure-dents, trop rigide, trop sec. Il plaît pourtant à ma langue, mes lèvres, orphelines. Je veux cette cigarette. Je veux cette femme dans mes bras. Elle est loin, du côté du Rhin, paraît-il. Elle porte une coupe de spritz à ses lèvres. Sa bouche s’entr’ouvre. Je me glisse avec le liquide. L’alcool ne corrompt pas la flaveur de sa bouche. Chaque goutte de sa salive m’enivre. Je nage sur sa langue. Je brasse. Mes cuisses s’ouvrent à chaque mouvement, appelant en leur sein une caresse de quelque chose.
Je ne comprends pas. Il suffit que je revienne à ce baiser pour que ma vulve pompe. Je mouille. Je dois trouver une solution. Faire la cuisine ? C’est une idée, bouger, danser, chanter, marcher, courir, que le corps se concentre sur un effort, que le souffle change de nature, que la chaleur se répande là où aucune excitation n’est possible. Où ? Je cherche. Pas un millimètre carré de ma chair se refuse à mon désir. C’est trop. Je dois me contenir. La couette est ouverte sur mon lit. La bouillotte dépasse un peu. Je résiste. C’est son baiser que je réclame, aucun ersatz.
Je pourrais réserver un billet de train. La référence ne me va pas. Je veux d’un plaisir autre que celui de la bagatelle, de la chair plus que du sexe, un baiser, celui de ce matin, pas un autre, un baiser qui étreint, avec de l’amour aussi. De l’amour ? Et puis quoi encore ? De la reconnaissance. Un baiser qui reconnaît sans attache. De l’amour sans attache ? Il va falloir que je change de texte. Le baiser dérape. Je me roule sur moi-même, la bouillotte entre les cuisses, le coin de la couette dans la main. Je ferme les yeux. Je me pelotonne sur moi-même. Où es-tu ?
— Viens.
∴
Le baiser est épuisé.
Je n’ai pas acheté de billet.
J’ai pris le train.
Puis un autre.
Encore un autre.
À chaque voyage, le contrôle est sans appel : billet non valide ; carte de réduction périmée. Pas de surprise. Aucune nouveauté à part le wifi disponible en première classe. C’était rude. J’ai laissé faire. Je ne veux plus. Je cherche un autre moyen de transport. J’ai tenté l’aventure dans la salle de sport. Il suffit de payer un forfait et tout y est : douche, serviette, machines, banc de musculation. On sue. Les muscles bandent. Ma vulve se tasse sous l’effort.
L’histoire revient en boucle. Je veux en sortir, recouvrer l’émotion. J’ai tenté de porter plainte. La fliquette n’était pas commode. Cela me rappelle… Je fuis. Je cours. Je suis en manque ; ma chair, plutôt parce que moi, j’ai le texte, l’écriture, la maîtrise de l’histoire, ou pas. Je m’y balade. J’y jouis autant que verbe peut. J’y mouille. Je m’y confonds. Je jette un œil sur Twitter. Quelques lignes ont suffi à alimenter mon émoi. Une sorte de douleur s’empare de mes avant-bras. Je me précipite sur le rameur. Je rame. J’enchaîne une série de trente mouvements rapides et une série de dix en récupération. La propriétaire de la salle s’approche.
— Ouvre ta cage thoracique quand tu respires.
J’ouvre. Elle passe derrière moi et pose ses mains sur mes épaules. Elle tire sur l’arrière. Mes omoplates se resserrent. Mes poumons prennent l’air. Les poignées des appareils sortent de mes mains. Le siège ne glisse plus sur le rail. Mes pieds transpercent les cales. Je suis vautrée sur un tas de pièces détachées. La moquette est trempée. Le feu a tout ravagé. J’ouvre les yeux. Je suis seule. Et mon désir croît.
[Cy Jung®, mai 2019]