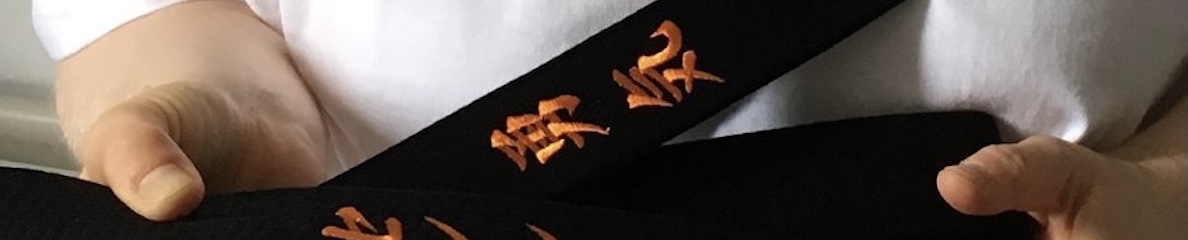L’actualité est émaillée de « faits divers » où des enfants disparaissent, se noient, sont assassinés, violés, ont des accidents… Cet été, par exemple, à quelques jours d’intervalle, trois enfants autistes se sont noyés en Île-de-France, ce qui a valu des articles sur leur fragilité particulière et la nécessité d’une surveillance accrue. Ah bon ? Cette énième découverte de l’eau chaude dans les médias grand public est sans doute la conséquence d’une tournure de langage qui leur est chère : tout enfant à qui il arrive quelque chose a « échappé à la surveillance » de ses parents, des moniteurs, de… qu’importe !
Que nous dit cette façon de parler ? Que c’est l’enfant qui est responsable des événements. Il « s’échappe » alors que l’adulte, lui, assure la « surveillance ». Cette formule est d’autant plus obscène quand il s’agit d’enfants autistes ou ayant une déficience intellectuelle car, pour s’échapper, il faut en avoir la volonté. Dans le cas de ces noyades estivales, une a eu lieu lors d’un séjour de vacances dédié aux enfants handicapés avec un taux d’encadrement de onze adultes pour douze enfants. Faut-il être matois pour se faire la belle !
Ces abus de langage ne sont là que pour dissimuler les inconséquences d’une société qui refuse la notion même d’accident, en rejetant la faute sur celui qui n’en a pas la responsabilité, l’enfant. C’est aussi, dans le cas des enfants autistes, le symptôme d’une société qui ne sait pas prendre en charge les besoins réels de ces enfants, privilégiant au final un enfermement en structures médico-sociales d’où il est plus difficile de s’échapper. Surveiller et punir ; on en est toujours là !
NB. En cherchant des ressources pour ce billet, j’ai trouvé cet article où un responsable associatif déplore aussi l’utilisation de l’expression « échapper à la surveillance » et préfère « défaut de surveillance ». On est d’accord.