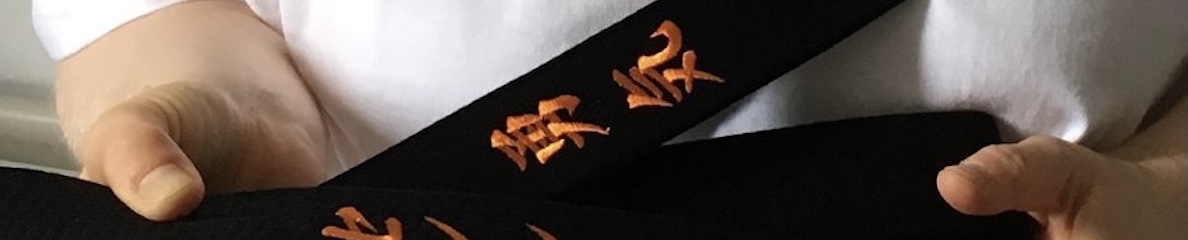J’aime toujours autant saisir des instants dans les conversations des personnes que je croise. Je n’écris plus de nouvelles à partir de ces anecdotes ; parfois je le regrette un peu, pas tant parce que je n’écris plus mais parce que c’est une occasion perdue de partager quelque chose de délicieux.
Ce matin, je suis allée chercher du pain. Au retour, au milieu du trottoir, je remarque une grande dame dans les 70 ans avec une petite fille et un chien de petite taille. Au moment où j’arrive, la dame tire son chien vers le caniveau afin qu’il fasse ses besoins. Celui-ci n’en a cure et s’installe sur le bord du trottoir. La dame d’un ton assez autoritaire gronde son chien :
— Mais qu’est-ce que c’est que ça !
À cet instant, le chien dépose une déjection au sol et la petite fille répond d’un ton entendu :
— C’est du caca.